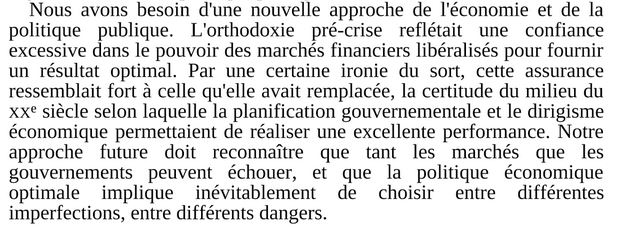Quand un acteur de la finance s’attaque à la pollution par la dette
Par RST le lundi, 29 mai 2017, 15:42 - Notes de lecture - Lien permanent
 J’ai
déjà eu l’occasion de signaler la parution du livre d’Adair Turner à travers un
billet écrit par Edouard Cottin-Euziol fin 2015. La traduction complète,
intitulée « Reprendre le contrôle de la dette – Pour une réforme radicale
du système financier » a depuis été publiée sous la direction de l’épatant
Gaël Giraud. Je ne peux qu’en recommander la lecture parce que c’est un livre
en tout point remarquable et parce qu’il a été écrit, non pas par un doux rêveur
utopiste, mais par un acteur du système. En effet, Adair Turner a notamment été
président de l’Autorité des services financiers, le régulateur britannique. Vous
trouverez une présentation
exhaustive de cet ouvrage sur le site d’Alain Grandjean et je vous propose
ci-après, les quelques réflexions que m’ont inspiré ce livre fondamental pour
la compréhension de notre système économique, du rôle de la finance et des réformes
drastiques à mettre en œuvre d’urgence.
J’ai
déjà eu l’occasion de signaler la parution du livre d’Adair Turner à travers un
billet écrit par Edouard Cottin-Euziol fin 2015. La traduction complète,
intitulée « Reprendre le contrôle de la dette – Pour une réforme radicale
du système financier » a depuis été publiée sous la direction de l’épatant
Gaël Giraud. Je ne peux qu’en recommander la lecture parce que c’est un livre
en tout point remarquable et parce qu’il a été écrit, non pas par un doux rêveur
utopiste, mais par un acteur du système. En effet, Adair Turner a notamment été
président de l’Autorité des services financiers, le régulateur britannique. Vous
trouverez une présentation
exhaustive de cet ouvrage sur le site d’Alain Grandjean et je vous propose
ci-après, les quelques réflexions que m’ont inspiré ce livre fondamental pour
la compréhension de notre système économique, du rôle de la finance et des réformes
drastiques à mettre en œuvre d’urgence.
Mettons les choses au point d’entrée de jeu : il n’y a rien de fondamentalement nouveau dans ce que décrit ou propose A.Turner. Lui-même rappelle que beaucoup de choses avaient déjà été anticipées dans les années 1920 et 1930 par des économistes comme Hayek, Fisher ou Keynes. Mais sa position d’acteur du système bercé initialement par les illusions de la théorie économique dominante donne d’autant plus d’importance et de pertinence à ses propos, qu’il a vu les choses de l’intérieur, qu’il a « mis les mains dans le cambouis ». Et même si son « coming out » peut apparaitre un peu naïf, il a le mérite de l’assumer et d’en tirer les conséquences sans se chercher d’excuses. Par ailleurs, au niveau de la forme, il revient à de nombreuses reprises sur les thèmes principaux traités, insistant sur les points importants ce qui facilite la lecture et la compréhension, notamment pour les profanes.
Le fil conducteur est, on s’en doute la dette, tant gouvernementale que privée : « Le problème fondamental est que les systèmes financiers modernes fabriquent inévitablement une quantité excessive de dettes lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes et en particulier des dettes qui ne financent aucun investissement dans des actifs nouveaux, mais plutôt le rachat d’actifs existants, notamment immobiliers ». C’est ce que Turner appelle la « mauvaise sorte de dette » qui crée une pollution comparable à la pollution environnementale et qui est l’origine principale de la grave crise de 2007-2008 dont nous continuons à subir les conséquences aujourd’hui. Et cette dette-là, n’apporte aucune contribution à la sacro-sainte croissance, démontrant par la même, pour ceux qui en doutaient encore, que la financiarisation de l’économie, pas plus que la libéralisation à outrance – des flux de capitaux par exemple –, ne sont, par définition, nécessairement bénéfiques mais qu’elles créent plutôt de l’instabilité sur les marchés et au niveau macroéconomique.
Pour lutter contre la hausse excessive du crédit et sa mauvaise allocation, au cœur de tous nos problèmes – et notamment de la récession post-crise – Turner nous explique de manière très pédagogique et argumentée qu’il faut s’attaquer à ses origines principales au nombre de trois et qui sont : la hausse de l’immobilier, les inégalités et les déséquilibres globaux des balances de paiement courants. Pour cela, réguler les banques est certes nécessaire – et la question du 100% monnaie est largement discutée – mais certainement pas suffisant. Il faut aussi autoriser la création monétaire par le gouvernement qui, sous certaines conditions, s’avère moins dangereuse que la création de crédit par le secteur privé : « L’orthodoxie pré-crise a été trop laxiste envers la création de crédit privé et trop stricte dans son interdiction de la monnaie fiduciaire ». Et il y a urgence, le coche ayant déjà été loupé en 2008. Turner insiste d’ailleurs beaucoup sur les réactions d’un pays comme la Chine dont le choix, écrit-il « aura d’immenses conséquences sur la stabilité financière globale pour la prochaine décennie » mais aussi sur celles de la zone euro qui risque de ne pas survivre si des mesures allant vers beaucoup plus de fédéralisme ne sont pas rapidement prises.
Il est impossible de résumer un livre aussi riche que celui-ci. Les lignes ci-dessus ne constituent qu’un très bref aperçu du sujet traité. Et l’auteur lui-même reconnait dans la postface à l’édition française écrite dix-huit mois plus tard, qu’il aurait aimé aborder d’autres points comme la question de la « stagnation séculaire » ou le rôle des technologies informatiques sur le long terme. Peut-être l’objet du prochain livre ? En tous les cas, il ne change rien à ses concluions qui, me semble-t-il, sont bien illustrées dans le passage que je reproduis ci-après et qui reflète bien l’état d’esprit dans lequel a été écrit ce livre :