De la crise de trop à la "Récommune" faudra-t-il passer par la case Révolution ?
Par RST le samedi, 8 août 2009, 10:08 - Notes de lecture - Lien permanent
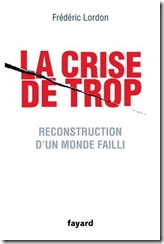 J’ai donc lu le dernier livre de
Frédéric Lordon intitulé "La crise de trop". Contrairement à certains
privilégiés, j’ai du l’acheter (je précise tout de suite que je ne le
regrette pas). Signe des temps, il trônait fièrement en tête de gondole dans
mon magasin FNAC. Le fait qu’il soit publié chez Fayard n’y est certainement
pas pour rien. Je ne suis pas un spécialiste du monde de l’édition, mais il me
semble que cela procède d’une certaine reconnaissance du travail de Lordon qui
fait visiblement partie maintenant des auteurs "bancables".
J’ai donc lu le dernier livre de
Frédéric Lordon intitulé "La crise de trop". Contrairement à certains
privilégiés, j’ai du l’acheter (je précise tout de suite que je ne le
regrette pas). Signe des temps, il trônait fièrement en tête de gondole dans
mon magasin FNAC. Le fait qu’il soit publié chez Fayard n’y est certainement
pas pour rien. Je ne suis pas un spécialiste du monde de l’édition, mais il me
semble que cela procède d’une certaine reconnaissance du travail de Lordon qui
fait visiblement partie maintenant des auteurs "bancables".
Commençons par expédier les
préliminaires d’usage : Lordon n’est pas seulement un économiste, c’est un
écrivain, un vrai. Son style est jouissif, le lire est un vrai régal, même si
il faut parfois s’y reprendre à deux fois pour saisir une tournure de phrase un
peu sophistiquée, agrémentée d’une pointe d’humour sarcastique. Ceci étant
posé, signalons que rien ne m’obligeait à l’acheter ce bouquin puisqu’une
grande partie de son contenu avait déjà été publié en plusieurs épisodes sur le blog de l’auteur.
Mais bon, quand on aime on ne compte pas … ses 19 euros !
Venons en maintenant au contenu.
Lordon l’annonce d’emblée dans l’introduction, ce dont nous avons besoin pour
sortir de la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons c’est d’une
"nouvelle donne" et d’une force politique – inexistante actuellement
– pour la mettre en œuvre, qui aurait perçu le caractère historique du moment
et l’état de révolte – sinon révolutionnaire – de la société. Car ne nous y trompons pas, cela se ressent
tout au long de l’ouvrage: F.Lordon est un homme en colère, écœuré par les
turpitudes du capitalisme et du monde de la finance. S’il n’appelle pas
franchement à l’insurrection, il constate cependant que le niveau
d’exaspération de la société a atteint un seuil critique et il s’étonne d’une
certaine manière que la révolution n’ait pas encore eu lieu. Il ne croit pas à
"une Pentecôte morale qui verrait la
vertu de modération, tel l’Esprit saint, descendre sur les capitalistes"
et arrive donc à la conclusion logique que seule l’épreuve de force permettra
d’envisager des possibilités de changement. La question que l’on peut alors
légitimement se poser est quelle forme cette épreuve de force doit-elle
prendre ? Faudra-t-il sortir les fusils et les barres de fer comme en
Argentine en 2001 ?
Dans le premier chapitre de
l’ouvrage, Lordon dénonce l’un des maux récurent de notre époque, à savoir
l’impérieuse nécessité de désigner des responsables lorsque survient une crise.
Si cette étape s’avère nécessaire à un moment donné, elle n’est pas prioritaire
car elle peut occulter la mise à jour des causes réelles qui ont engendré la
situation critique. Dans le cas particulier de la crise économique, ce sont les
structures mises en place qui en sont à l’origine car elles ont déterminé les
comportements des différents acteurs : "Il faut impérativement détourner le regard des individus, réputés seuls
auteurs de leurs actes et de leurs désirs pour apercevoir que ce sont les
structures qui configurent, on pourrait même dire définissent, les intérêts des
agents et fixent la marge de manœuvre qui leur est accordée pour les poursuivre".
Une fois que la question des structures – "celles de la libéralisation internationale des marchés de capitaux
comme celles, plus généralement, de ce qu’on nomme par raccourci la
mondialisation" – a été correctement posée, on peut alors s’attaquer
aux responsables qui ont mis en place ces structures. Et là, le constat est
sans appel, ce sont les Etats qui ont été à l’œuvre avec, dans le rôle de
grands architectes en France, les socialistes. On ne s’attardera pas ici sur le
démontage en règle proposé par l’auteur, du rôle des responsables socialistes –
Rocard et Delors en tête –, de la complicité coupable des éditorialistes passés
maitre dans l’art de retourner leur veste, et de celui des experts, tout ces
"gardiens de la structure"
dont la responsabilité "n’est pas
moindre que celle de ses architectes". Il faut lire dans le texte la
prose de l’auteur pour en apprécier toute la saveur à sa juste valeur.
Dans le chapitre suivant, Lordon
part du constat historique que "le
déchaînement sans frein de la pulsion d’accumulation ravage les sociétés".
Il met aussi en évidence la grande résurgence des inégalités qui s’appuie sur
des conceptions quelque peu biaisées des notions de compétence et de mérite
surtout lorsque l’on constate que "Nulle
part il n’y a de mètre-étalon objectif du mérite, qu’il soit moral ou
« contributiviste », mais seulement des processus de pouvoir qui
règlent des partages inégaux". Se pose alors la question de la nécessaire
limitation des rémunérations des traders, banquiers et grands patrons regroupés
sous le vocable de "compétents",
mais qui aurait pour conséquence potentielle, leur fuite vers des cieux plus
cléments. Chiche, nous dit Lordon qui démontre que, cela serait-il le cas, et
en supposant qu’ils trouvent à s’employer ailleurs – hypothèse hasardeuse
compte tenu du contexte économique peu favorable – nous n’aurions pas vraiment
à nous en plaindre vue "l’énormité du désastre dont ils ont été les
fauteurs" et du fait que les candidats potentiels pour les remplacer
ne manqueront pas.
Lordon s’attaque ensuite au cœur
du capitalisme, le système bancaire. Il nous explique pourquoi la
nationalisation de ce système s’avère nécessaire. Malgré les milliards injectés
par l’Etat, les banques se montrent extrêmement prudentes quand il s’agit de
prêter, par crainte d’avoir à faire face à de nouvelles mauvaises créances.
Cette réticence entraîne des difficultés supplémentaires pour les acteurs
économiques, créant ainsi un cercle vicieux par lequel la récession s’auto
entretient. Apparait alors ce que Lordon
qualifie de "problème par excellence"
des économies de marché, à savoir l’absence de toute coordination. En effet,
"Pour qu’une banque consente à
prêter, il lui faudrait la certitude que toutes les autres prêteront avec elle
et que sa propre contribution ne sera pas qu’un coup d’épée isolé dans l’eau
d’une mer démontée". Apparait alors la nécessité d’une "main visible et suffisamment puissante pour
prendre les commandes et imposer à tous de se régler sur une certaine ligne de
conduite". Et cette main visible c’est bien entendu l’Etat. La
nationalisation s’impose donc, à cause de la conjoncture mais pas seulement. En
effet, si l’on considère que "la
sécurité des encaisses monétaires est un bien public vital" et que,
comme l’ont montré les évènements en septembre-octobre 2008 "l’effondrement total des institutions
bancaires et financières des principaux capitalismes" est une possibilité non négligeable, alors on ne laisse pas la gestion de ce risque
aux mains d’intérêts privés et la nationalisation s’impose comme une évidence.
Mais il n’est pas non plus souhaitable de laisser entièrement la monnaie – compte
tenu de son pouvoir – dans les mains de l’Etat dont les dirigeants seraient
tentés d’abuser à des fins purement électoralistes. Il faut donc trouver un
compromis différent de celui qui existe actuellement. Lordon nous propose ce
qu’il appelle un système socialisé du crédit. L’émission monétaire, considérée
comme un service public, serait confiée à des concessionnaires dont le statut
définitif reste à préciser, mais qui assurerait que le pouvoir de décision soit
désindexé des rapports de participation financière, c'est-à-dire que le
fonctionnement se ferait sur le principe d’ « un homme une
voix » et non plus
d’ « une action une voix » : "Ni entités actionnariales privées, ni entités publiques sous le
contrôle direct de l’Etat, les concessionnaires devraient être des organisations,
sinon non profitables, du moins à profitabilité encadrée, c'est-à-dire limitée."
Après avoir instruit le procès
des structures de la finance, Lordon constate – avec regret, croit-on
comprendre – qu’il y a peu de chances que la crise donne lieu à une sortie du
capitalisme. Néanmoins, on peut espérer une transformation suffisamment
profonde des "structures
actionnariales et concurrentielles". Son analyse et ses propositions
sur ce sujet commencent avec ce qu’il appelle le paradoxe de la part salariale
dans le PIB dont j’ai déjà eu l’occasion de parler, ici.
Il enchaine avec une proposition
déjà ancienne – mais plus que jamais d’actualité – le SLAM (pour Shareholder
Limited Authorized Margin), mécanisme fiscal que nous ne détaillerons pas ici
et qui vise à limiter structurellement le pompage de la richesse de
l’entreprise par la finance actionnariale qui se gave au travers des
dividendes, plus values et autres buybacks,avec
comme finalité de réduire la pression sur les salaires imposés par la
contrainte actionnariale. Le SLAM de Lordon c’est l’arme anti TSR (Total
Shareholder Return ou rémunération actionnariale effective globale rapportée au
capital-actions investi), c’est le "raccourcisseur
de prétention actionnariale", c’est "le nom d’un possible coup d’arrêt" à la démesure de la finance
actionnariale, c’est enfin "une
proposition de transformation des structures de la finance actionnariale".
Mais c’est surtout la preuve que des propositions pratiques existent pour
construire une alternative à un système que l’on nous présente souvent comme le
seul possible.
Un seul regret cependant, que
Lordon n’ait pas repris le concept de Zone Européenne Financière (ZEF), régulée
par définition, et de Zones Non Régulées (ZNR) dont il parle dans la neuvième
proposition de son texte intitulé "Quatre
principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières".
Cela répond à l’objection
justifiée de
Après les contraintes
actionnariales, Lordon s’attaque à la contrainte concurrentielle qui s’avère
être la plus résistante à la critique et à la remise en cause "dans les sphères de la parole autorisée".
Après avoir démontré que le débat sur le protectionnisme est faussé dès le
départ puisque, du fait des structures – on y revient ! – nous vivons dans
un monde protectionniste, Lordon ramène le débat à son niveau pertinent, à
savoir comment corriger les distorsions existantes (fiscalité, protection
sociale, niveaux de vie, réglementation environnementale, taux de change, droit
du travail, tolérance sociale aux inégalités, préférence politique pour les
coûts collectifs de services publics) par des distorsions contraires et
compensatrices. Cela, mis à part la nécessaire volonté politique, ne pose pas
de difficultés particulières. Il suffirait par exemple que l’OMC fasse
correctement son travail. Au passage, Lordon démonte proprement la légende
utilisée comme argument ultime par les adeptes de la théorie « le
protectionnisme c’est la guerre » qui voudrait que le libre échange ait
favorisé le développement des nouveaux pays industrialisés. La réalité est
toute autre et l’on ne peut que déplorer
les "promesses frelatées de la
mondialisation concurrentialiste qui aura jeté ces pays dans des régimes de
croissance parfaitement déséquilibrés, misant tout sur l’exportation et, par
là, faisant l’impasse sur la constitution de leur marché intérieur"
Enfin, face à l’impossibilité d’envisager
un gouvernement mondial dans un avenir proche, nécessaire pour régulariser le
capitalisme mondialisé, Lordon propose de fonctionner sur la base d’espaces
régionaux pour substituer à la mondialisation ce qu’il appelle
l’interrégionalisation. Cela nécessitera au passage de refaire l’Europe dont le
bulletin de santé catastrophique devrait amener les autorités à la déclarer
trépassée. Et la crise est une occasion historique car elle a montré la vacuité
des traités Européens à en juger par le nombre d’articles sur lesquels les
Etats se sont proprement assis face afin d’échapper au scénario catastrophe.
Pour terminer et comme annoncé en
introduction, Lordon nous propose sa version d’une nouvelle donne possible envisageant,
sinon une sortie totale du capitalisme, tout au moins "d’en changer la face à un degré tel qu’on
hésiterait à le nommer encore « capitalisme »". A travers la
remise en cause de la vie salariale qui est "dans son essence indigne" et en s’appuyant – paradoxalement – sur
les valeurs de l’individualisme libéral qui exige l’égalité en droit et en
dignité de tous les hommes, il propose ni plus ni moins que de faire rentrer la
démocratie radicale partout et notamment dans le monde du travail, en créant les « récommunes » –
"res communa" sur le principe de la "res publica", forme
moderne et actualisée de l’autogestion – pour supplanter l’entreprise capitaliste,
"lieu du despotisme patronal".
"Dépasser le capitalisme, c’est donc
faire entrer en grand dans la sphère des rapports économiques, (…) l’exigence
démocratique radicale". La proposition de Lordon s’appuie sur le
constat impitoyablement réaliste et lucide des rapports de force dans le monde
du travail, de sa violence. Il démystifie le discours convenu et les pratiques
associées tendant à faire croire que le salarié est un
« collaborateur » maitre de son destin et non le serf des temps
modernes. Il n’idéalise pas la solution proposée et reste tout à fait conscient
des difficultés à surmonter et de ses défauts inhérents : "il n’existe aucune formule, pas plus
récommunale qu’autre chose, de la parfaite harmonie sociale". Comme
souvent, il indique une voie possible pour changer et les propositions qui vont
avec. A nous de nous les approprier et de les traduire en réalités. A nous de
faire de la politique !
Le positionnement de F.Lordon, on peut s’en douter, ne plaira pas à tout le monde. Il est regrettable cependant qu’un mensuel comme Alternatives Economiques se montre aussi négatif. Ainsi, dans son édition de Juin, Christian Chavagneux écrit-il que la posture et le ton de F.Lordon rendent difficiles le débat et la recherche de compromis, "ce qui n’est pas un véritable souci pour l’auteur, qui semble moins tenté de changer le monde que d’y mettre le feu". C’est réduire le propos de Lordon à bien peu de chose en insistant sur l’aspect « révolté » – qui est indéniable – et en faisant l’impasse sur les propositions, qui sont conséquentes. Mais surtout, c’est oublier que pour débattre et rechercher le compromis, il faut être deux et on ne voit pas actuellement les banquiers et autres grands patrons dans un état d’esprit propice à ce genre d’activité. L’ont-ils d’ailleurs jamais été ?