La France doit elle devenir "l’hôpital du continent" ?
Par RST le mercredi, 24 août 2011, 14:24 - Notes de lecture - Lien permanent
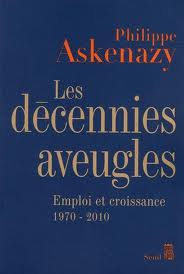 Faire de la France
l’hôpital du continent c’est, avec le développement d’une
industrie de la formation, les nouveaux paradigmes proposés par
l’économiste Philippe Askenazy pour assurer la croissance dans les
décennies à venir en développant ce qu’il appelle l’économie
des besoins. Le directeur de recherche au CNRS, accessoirement membre
éminent des Economistes Atterrés, est arrivé à cette conclusion
surprenante dans son ouvrage intitulé "Les décennies aveugles
- Emploi et croissance 1970-2010". Il y analyse brillamment les
différentes politiques économiques menées en France ces 40
dernières années, mais aussi celles menées dans les pays qualifiés
de modèles, pour ensuite proposer ce qu’il faudrait faire, selon
lui, pour assurer la croissance et vaincre le chômage. L’ambition
était louable et ce livre mérite d’être lu ne serait-ce que pour
combattre certaines idées reçues et pour constater que droite comme
gauche sont également responsables du marasme actuel. Mais, faute
d’imagination et de capacité à sortir des dogmes en vigueur, les
conclusions auxquelles arrive l’auteur sont décevantes.
Faire de la France
l’hôpital du continent c’est, avec le développement d’une
industrie de la formation, les nouveaux paradigmes proposés par
l’économiste Philippe Askenazy pour assurer la croissance dans les
décennies à venir en développant ce qu’il appelle l’économie
des besoins. Le directeur de recherche au CNRS, accessoirement membre
éminent des Economistes Atterrés, est arrivé à cette conclusion
surprenante dans son ouvrage intitulé "Les décennies aveugles
- Emploi et croissance 1970-2010". Il y analyse brillamment les
différentes politiques économiques menées en France ces 40
dernières années, mais aussi celles menées dans les pays qualifiés
de modèles, pour ensuite proposer ce qu’il faudrait faire, selon
lui, pour assurer la croissance et vaincre le chômage. L’ambition
était louable et ce livre mérite d’être lu ne serait-ce que pour
combattre certaines idées reçues et pour constater que droite comme
gauche sont également responsables du marasme actuel. Mais, faute
d’imagination et de capacité à sortir des dogmes en vigueur, les
conclusions auxquelles arrive l’auteur sont décevantes.
P. Askenazy débute son ouvrage en insistant sur ce qui constitue la toile de fond des quarante dernières années : la révolution industrielle organisée autour des technologies de l’information qui démarre au début des années 1970 aux Etats-Unis. Il montre que cette révolution s’est accompagnée d’une brusque rupture de la croissance de la productivité. Comme pour toute technologie à usage général – l’électricité par exemple – "ce n’est qu’après une phase de reconfiguration des méthodes de production, d’adaptation des institutions et des travailleurs que l’on observe les bénéfices productifs de cette technologie". Et c’est la capacité à prendre en compte les nouvelles conditions créées par cette révolution industrielle qui détermine le succès d’une économie. Le Royaume-Uni par exemple a fait le choix de l’industrie financière. On a pu parler de miracle britannique. La France aurait-elle loupé le coche alors que, selon l’auteur, les préconisations nécessaires avaient été faites dès 1967 à travers le rapport du commissaire au Plan François-Xavier Ortoli ?
L’auteur passe en revue les différentes politiques menées depuis 1974. Nous ne donnerons ici que les conclusions qui se dégagent de l’analyse en recommandant, pour les détails, de se rapporter à l’ouvrage.
1974-1981 : les politiques déformatrices
"Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing a profondément modifié les fondamentaux de l’économie française (…) il laisse en héritage une série de problèmes qu’il a lui-même structurés : stigmatisation des immigrés et des jeunes, précarisation de l’emploi notamment des trajectoires d’entrée dans le marché du travail, hausse des prélèvements obligatoires, en particulier de ceux qui pèsent sur le travail. En clair, de lourds « maux » économiques et sociaux français actuels sont les résultantes des politiques initiées par Jacques Chirac et surtout Raymond barre"
1981-1986 : de la rupture aux abandons
" Trompée dès le départ par le diagnostic totalement erroné des experts économiques, la majorité de gauche n’a donc pas su faire mieux que le septennat de Giscard sur le front de l’emploi et du chômage, tout en reprenant, même partiellement, les recettes impulsées par Chirac et Barre.
(…) L’héritage de la gauche est cependant sensible sur le plan social."
1986-1993 : du libéralisme dur au libéralisme soft
"Au total, cette législature confirme le tournant idéologique des socialistes entre un rocardisme gestionnaire et centriste, et un mitterrandisme muté par ses techniciens sans base idéologique franche. Tout en acceptant une économie de marché libéralisée, les socialistes se refusent à proposer une politique de changement des structures économiques et de conquêtes sociales.(…)
Le défaitisme économique du mitterrandisme finissant s’affirme alors sans ambigüité (…).
La gauche rocardo-mitterrandienne au pouvoir avoue sa tragique impuissance"
1993-2002 : de « nouvelles » politiques efficaces ?
" La France va connaître durant cette période des créations d’emplois massives, laissant espérer la fin du chômage de masse dans un environnement international euphorique. Mais cette période faste est aussi celle d’un déclin technologique relatif de la France (…)
Obnubilée par le développement de l’emploi peu qualifié que les experts appelaient de leurs vœux, et aveuglée par une croissance retrouvée et un chômage contenu, la France n’entre pas pleinement dans la société de la connaissance."
2002-2007 : la décomposition
"Après une décennie 1990 où la politique avait démontré une certaine prise sur la création d’emplois, l’impuissance et la confusion semblent de retour. L’environnement macroéconomique était pourtant globalement favorable. (…)
En cinq ans, la croissance n’a jamais décollé. La décennie de retard dans la bataille de l’innovation commence à peser sur les performances des entreprises. Les excédents commerciaux se muent en déficits (…). Les politiques de l’emploi mises en place à la fin du siècle arrivent à saturation et coûtent de plus en plus cher pour de moins en moins d’efficacité. Entre faible croissance et pression sur l’emploi, les salaires de la grande majorité des travailleurs stagnent (…)"
2007-2010 : l’avalanche
"L’ensemble des mesures mises en œuvre depuis 2007 procède donc des mêmes caractéristiques : volontarisme malgré la crise, coût énorme pour les finances publiques, redistribution vers les entreprises ou les plus fortunés, machisme, saupoudrage pour les plus modestes, rapidité de mise en œuvre et corrélativement absence de réflexion sur les effets pervers de ces mesures.(…) Ils risquent de léguer à terme un Etat budgétairement affaibli, des services publics défaillants, une France plus fracturée, insuffisamment éduquée et innovante, avec le spectre de ne jamais sortir du chômage de masse qui la ronge depuis trop longtemps."
J’aurai l’occasion de revenir sur ce livre qui, malgré des conclusions peu convaincantes, propose de nombreux sujets de réflexion sur les politiques économiques menées depuis 40 ans.