L’Etat punitif comme mode de gouvernement des inégalités
Par RST le dimanche, 14 juin 2015, 12:03 - Notes de lecture - Lien permanent
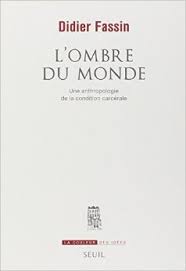 J’ai toujours eu un gros problème :
je suis une feignasse ! Plutôt donc que de passer du temps à rédiger une
note de lecture sur un livre essentiel consacré au système carcéral, je me suis
contenté d’en proposer un passage qui résume bien, selon moi, l’analyse
centrale.
J’ai toujours eu un gros problème :
je suis une feignasse ! Plutôt donc que de passer du temps à rédiger une
note de lecture sur un livre essentiel consacré au système carcéral, je me suis
contenté d’en proposer un passage qui résume bien, selon moi, l’analyse
centrale.
Si vous voulez comprendre pourquoi les prisons se
remplissent alors que la criminalité n’augmente pas nécessairement en
proportion, comment la chaine pénale entraine une surreprésentation des milieux
populaires et des minorités ethno raciales
en milieu carcéral, prendre conscience que la privation de liberté n’est en
réalité pas le seul châtiment réservé aux détenus, ou être convaincu des dégâts
de la politique du chiffre et de la mise en place des peines plancher, lisez « L’ombre
du monde – Une anthropologie de la condition carcérale » de Didier Fassin.
« Pour comprendre la prison, il faut savoir qui on y enferme, pour quoi, pour combien de temps - et sûrement aussi qui on n'y enferme pas. Dès lors, les évolutions des sensibilités, des discours, des politiques, des législations, des pratiques policières et des décisions judiciaires sont indissociables de toute étude du monde carcéral puisque ce sont elles qui déterminent ce qu'en sera la composition démographique. La prison cristallise en effet toutes ces transformations: elle est l'aboutissement des processus qu'elles mettent en œuvre et le réceptacle des populations qu'elles concernent. Dans son cours, Michel Foucault analyse en particulier comment se déplace, avec l'essor de la bourgeoisie et le développement du capitalisme au début du XIXe siècle, la ligne de partage entre les illégalismes populaires, tels que la fraude et la contrebande, jusqu'alors tolérés et même encouragés parce qu'en contournant la loi ils contribuaient au dynamisme économique, et la délinquance, caractérisée notamment par le vol, désormais constituée en danger pour l'ordre social et en objet d'une morale punitive; dans le même temps, les classes dirigeantes s'octroient le pouvoir exclusif de faire échapper à la loi et à sa sanction leurs propres illégalismes. Si l'on poursuit cette analyse jusqu'à la période contemporaine, on ne trouve évidemment pas un continuum, mais plutôt, comme on l'a vu précédemment, des moments historiques pendant lesquels diverses théories pénales et diverses idéologies correctives sont testées, s'imposent, se déploient, puis sont combattues, reculent, disparaissent: ainsi, après les années d'expérimentation sociale du redressement et de la réinsertion au milieu du XXe siècle vient le temps de la répression qui en caractérise les dernières décennies. Ce qui, quelle que soit l'époque, demeure structurellement constant toutefois, c'est d’une part l'établissement de lignes de partage entre ce qui doit être puni et ce qui est toléré et d'autre part l'existence de modalités différenciées de distribution et d'application des sanctions.
Tout le travail symbolique du pouvoir est d'effacer ces opérations et de représenter comme allant de soi ces lignes et ces modalités. Au cours de la période récente, il a consisté en particulier à susciter des peurs et déplacer des anxiétés, à concentrer l’attention du public sur l'insécurité plutôt que sur les inégalités tout en dissociant les deux problèmes, à constituer en catégories dangereuses certaines populations et certains territoires, à singulariser la récidive comme appelant des dispositifs punitifs d’exception indépendamment de l'impact sur sa prévention, à rendre évident le fait que la conduite avec perte des points de permis ou l'usage et détention de cannabis doivent davantage mobiliser les ressources judiciaires que les délits financiers et les abus de biens sociaux, à justifier au nom de la rapidité et de l'efficacité de la justice la mise en place de procédures défavorables de comparution immédiate pour un nombre croissant de prévenus accusés de délits souvent mineurs, ou encore à faire apparaître comme de bon sens qu'une peine de prison ferme même courte doive être exécutée en prison, fût-ce longtemps après la commission des faits condamnés et au détriment de l'insertion des personnes concernées. C'est donc cette forme de naturalisation des problèmes - au sens où des opérations sociales sont présentées comme «naturelles» - qu'il s'agit de dévoiler. »
Extrait de «L'ombre du Monde – Une anthropologie de la condition carcérale » par Didier Fassin